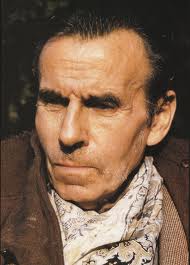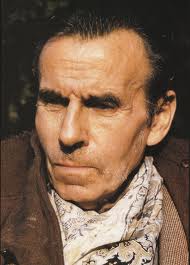|
DÉLIRES
- "
Il faut que j'entre dans le
délire, que je touche au plan
Shakespeare car je suis
incapable de construire une
histoire avec l'esprit logique
des Français. "
(Robert de St Jean, Cahiers Céline
1, p. 51).
- " C'est l'âge aussi qui vient peut-être, le
traître, et nous menace du pire.
On n'a plus beaucoup de musique
en soi pour faire danser la vie,
voilà. Toute la jeunesse est
allée mourir déjà au bout du
monde dans le silence de vérité.
Et où aller dehors, je vous le
demande, dès qu'on n'a plus en
soi la somme suffisante de
délire ?
La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde
c'est la mort. Il faut choisir,
mourir ou mentir. Je n'ai jamais
pu me tuer moi. "
(Voyage au bout de la nuit, Poche,
1968, p.202).
Vie supportable que
transformée en délires...
Romans,
guignol, cirque, films, théâtre,
opérettes, Céline en avait plein
la tête. Seule la médecine le
ramenait à la réalité. Sorti du
dispensaire, Destouches
redevenait Céline. La vie
n'était supportable que
transformée en mythes, légendes,
musiques, délires. Combien de
fois le mot " délire " ou ses
synonymes apparaissent sous sa
plume ! Dès le 25 mai 1916, en
route pour le Cameroun, il écrit
à Simone Saintu en se lançant
dans un délire dont les
sonorités, et la cadence
montrent le plaisir d'écrire : "
Je vois par-ci par-là errer des
requins, quelques baleines, une
foule de poissons volants, des
nègres, le tout sur fond vert -
sautant, vaguant, roulant,
valsant au son d'un piston de machinerie que
j'entendrai encore au Jugement
Dernier et par raffinement
futuriste quelques renards
par-ci par-là. " (Lettres,
16-9)
piston de machinerie que
j'entendrai encore au Jugement
Dernier et par raffinement
futuriste quelques renards
par-ci par-là. " (Lettres,
16-9)
Le 20 décembre 1929 à Joseph Garcin : " Vous avez l'enthousiasme et toutes
ces aventures qui alimentent mon
délire. Vous connaissez mon
projet. "
Le 21 mars 1930, au même Garcin : " Vous le savez j'écris un roman,
quelques expériences
personnelles qui doivent tenir
sur le papier, la part de folie,
la difficulté aussi, labeur
énorme... "
Le 4 août 1930, à Garcin encore : " Connaissez-vous les travaux de Freud ?
[...] Tout ceci alimente mon
délire, et le jeu est à la mode
- Il faut jouer, ou se taire une
fois pour toutes. "
En avril 1931, toujours à Joseph Garcin : " Oui Mahé est un grand
connaisseur de collégiennes en
cavale. [...] Ensemble nous
encourageons les danseuses,
entrée des artistes. Quelles
grâces, et envols et fines
ondes. Nous travaillons pour le
délire - consommation sans doute
mais vous le savez, j'aime les
filles saines et délivrées et un
peu lesbiennes, alors je me
régale. Au théâtre, je me cache
derrière le rideau, il faut pour
l'orchestre toutes ses artères,
et l'âge est là inexorable. "
(Lettres, 31-4)
Dans
Voyage au bout de la nuit
: " A 37 ° tout devient banal. "
Comme l'a si bien dit Pol
Vandromme, " Céline est un
écrivain enfiévré ".
Le 30 septembre 1932, il écrit à Cillie Ambor : " Je suis en train de me
mettre en route pour un nouveau
livre et il va falloir pendant
quelques années à nouveau sortir
de la vie pour tenir cet espèce
de délire en élan. "
(Lettres, 32-19)
En décembre 1932, il déclare à Mery Bromberger : " Céline est un loufoque,
voilà tout ! Qu'on n'y voie pas
des tranches de vie, mais un
délire. Et surtout pas de
logique. Bardamu n'est pas plus
vrai que Pantagruel et Robinson
que Picrochole. Ils ne sont pas
à la mesure de la réalité. Un
délire ! "
Le 20 février 1933, Robert de Saint-Jean note que lors d'un dîner chez
Ramon Fernandez, Bernanos et
Vallery-Radot essaient de
prouver à Céline que " le délire
de ses personnages trahit chez
lui une soif de surnaturel. "
(Eric Mazet, Céline et les femmes, Spécial Céline n° 19, hiver 2016, p.
72).
*********
LE STAND DES
NATIONS.
Au
fronton de la baraque on lisait
son vieux nom en vert et rouge ;
c'était la baraque d'un tir : Le
Stand des Nations qu'il
s'appelait. Plus personne pour
le garder non plus. Il tirait
peut-être avec les autres
propriétaires à présent, avec
les clients.
Comme les petites cibles dans la boutique en avaient reçu des balles !
Toutes criblées de petits points
blancs ! Une noce pour la
rigolade que ça représentait :
au premier rang, en zinc, la
mariée avec les fleurs, le
cousin, le militaire, le promis,
avec une grosse gueule rouge, et
puis au deuxième rang des
invités encore, qu'on avait dû
tuer bien des fois quand elle
marchait encore la fête.
- Je suis sûre que vous devez bien tirer, vous Ferdinand ? Si c'était la
fête encore, je ferais un match
avec vous !... N'est-ce pas que
vous tirez bien Ferdinand ?
- Non, je ne tire pas très bien...
Au
dernier rang derrière la noce,
un autre rang peinturluré, la
Mairie avec son drapeau. On
devait tirer dans la Mairie
aussi quand ça fonctionnait,
dans les fenêtres qui
s'ouvraient alors d'un coup sec
de sonnette, sur le petit
drapeau en zinc même on tirait.
Et puis sur le régiment qui
défilait, en pente, à côté,
comme le mien, place
 Clichy,
celui-ci entre les pipes et les
petits ballons, sur tout ça on
avait tiré tant qu'on avait pu,
à présent sur moi on tirait,
hier, demain. Clichy,
celui-ci entre les pipes et les
petits ballons, sur tout ça on
avait tiré tant qu'on avait pu,
à présent sur moi on tirait,
hier, demain.
- Sur moi aussi qu'on tire Lola ! que je ne pus m'empêcher de lui crier.
- Venez ! fit-elle alors... Vous dites des bêtises, Ferdinand, et nous
allons attraper froid.
Nous descendîmes vers
Saint-Cloud par la grande allée,
la Royale, en évitant la boue,
elle me tenait par la main, la
sienne était toute petite, mais
je ne pouvais plus penser à
autre chose qu'à la noce en zinc
du Stand de là-haut qu'on avait
laissée dans l'ombre de l'allée.
J'oubliais même de l'embrasser
Lola, c'était plus fort que moi.
Je me sentais tout bizarre.
C'est même à partir de ce
moment-là, je crois, que ma tête
est devenue si difficile à
tranquilliser avec ses idées
dedans.
Quand nous parvînmes au pont de Saint-Cloud il faisait tout à fait sombre.
- Ferdinand, voulez-vous dîner chez Duval ? Vous aimez bien Duval, vous...
Cela vous changerait les
idées... On y rencontre toujours
beaucoup de monde... A moins que
vous ne préfériez dîner dans ma
chambre ? - Elle était bien
prévenante, en somme, ce
soir-là.
Nous nous décidâmes finalement pour Duval. Mais à peine étions-nous à
table que l'endroit me parut
insensé. Tous ces gens assis en
rang autour de nous me donnaient
l'impression d'attendre eux
aussi que des balles les
assaillent de partout pendant
qu'ils bouffaient.
-
Allez-vous en tous ! que je les
ai prévenus. Foutez le camp ! On
va tirer ! Vous tuer ! Nous tuer
tous !
On m'a ramené à l'hôtel de Lola, en vitesse. Je voyais partout la même
chose. Tous les gens qui
défilaient dans les couloirs du
Paritz semblaient aller se faire
tirer et les employés derrière
la grande caisse, eux aussi,
tout juste faits pour ça , et le
type d'en bas même, du Paritz,
avec son uniforme bleu comme le
ciel et doré comme le soleil, le
concierge qu'on l'appelait, et
puis des militaires, des
officiers déambulants, des
généraux, moins beaux que lui
bien sûr, mais en uniforme quand
même, partout un tir immense,
dont on ne sortirait pas ni les
uns ni les autres. Ce n'était
plus une rigolade.
-
On va tirer ! que je leur criais
moi, du plus fort que je
pouvais, au milieu du grand
salon. On va tirer ! Foutez donc
le camp tous !... Et puis par la
fenêtre que j'ai crié ça aussi.
Ça me tenait. Un vrai scandale.
" Pauvre soldat ! " qu'on
disait. Le concierge m'a emmené
au bar bien doucement, par
l'amabilité. Il m'a fait boire
et j'ai bien bu, et puis enfin
les gendarmes sont venus me
chercher, plus brutalement eux.
Dans le Stand des Nations il y avait aussi des gendarmes. Je les avais
vus. Lola m'embrassa et les aida
à m'emmener avec leurs menottes.
Alors je suis tombé malade,
fiévreux, rendu fou, qu'ils ont
expliqué à l'hôpital, par la
peur.
C'était possible. La meilleure des choses à faire, n'est-ce-pas, quand on
est dans un monde, c'est d'en
sortir ? Fou ou pas, peur ou
pas.
(Voyage au bout de la nuit, Poche, 1968, p.63).
*********
Le
VOYAGE... Un DELIRE...
Une
autobiographie mon livre ? C'est
un récit à la troisième
puissance. Céline fait délirer
Bardamu qui dit ce qu'il sait de
Robinson. Qu'on n'y voie pas des
tranches de vie, mais un délire.
Et surtout pas de logique.
Bardamu n'est pas plus vrai que
Pantagruel et Robinson que
Picrochole. Ils ne sont pas à la
mesure de la réalité. Un délire
!
Le fond de l'histoire ? Personne ne l'a compris. Ni mon éditeur, ni les
critiques, ni personne. Vous non
plus ! Le voilà ! C'est l'amour
dont nous osons parler encore
dans cet enfer, comme si l'on
pouvait composer des quatrains
dans un abattoir.
L'amour impossible aujourd'hui. Robinson le cherche comme chacun, avec
l'argent, cet autre bien
indispensable. Il finit enfin
par trouver un coin tranquille,
des rentes, une petite femme qui
l'aime. Pourtant, il ne peut pas
en rester là. Il lui faut partir
quand il a le bonheur bourgeois
sous la main, une petite maison,
une épouse câline, des poissons
rouges.
Il se dit
qu'il est fou pour être comme
cela. Il s'en va. Madelon le
poursuit. Elle ne croit pas
qu'il soit fou et lui le
comprend aussi. Il n'est
seulement pas assez égoïste pour
être heureux. La petite
l'assaille. Elle ne comprend
rien. Lui, pour en sortir et
sortir de lui-même, voudrait
être héroïque dans son genre.
Mais il ne sait pas comment. A
la fin, dans le taxi, il trouve.
Il dit à Madelon que ce n'est
pas elle mais l'univers entier
qui le dégoûte. Il le dit comme
il peut et il en meurt.
Personne n'a compris. Il est raté, hein, mon bouquin ? Mais si ! Mais si
! Je le sais bien. Je l'ai
compris quand j'ai dû le relire.
Si j'avais la force de
Dostoïevsky, je le
recommencerais. J'entrerais de
nouveau dans la vie, frappant un
coup à droite, un coup à gauche.
Mais je n'ai plus la force. J'ai
40 ans, je suis malade. Un homme
fini. Si seulement il y a dans
ce bouquin trois pages sur six
cents qui vaillent quelque
chose, cela me suffit.
(Interview avec Merry Bromberger, Cahiers Céline 1, Céline et
l'actualité littéraire,
Gallimard, NRF, mai 1985, p.30).
*********
Délire
au Consulat.
-
Allons ! Allons ! mon ami !...
Vous êtes nerveux voilà tout
!... Vous avez fait votre devoir
!... Tout votre devoir !...
Voulez-vous retourner en France
?... Vous voulez voir le Consul
?... Vos ressources sont-elles
épuisées ?... On va vous
rapatrier !... Quelle est votre
profession ?...
Il m'excède ce radoteux !
- Assez !... je lui fais... Ça suffit... Assez
de vos mimiques !... Je veux
remonter en ligne !... Entendu
?... Je veux refaire tout mon
devoir...C'est net ! Tout seul
s'il le faut !... Je veux tout
tuer !... Attention Monsieur le
Major !... ça ne se passera pas
comme ça !... Je veux pas
retourner à Paris !... Je veux
remonter en ligne !... comme
Lucien Galant !... Benoît-la
-Moustache !...
- Mais vous ne pouvez pas mon ami ! Vous avez 80 pour 100 !...
- Alors je vais vous assassiner !... que je lui réponds tac au tac.
- Passez-moi un sabre !...
Et je saute sur le tisonnier que je vois là tout près... dans le seau à
charbon... Je vais lui
transpercer la paillasse !... à
ce barbichou !...
Ils se
jettent alors à quatre sur moi
!... Ils me terrassent !... ils
me brutalisent !... Je lutte à
coups de pieds !... Je les
mords!... Ils m'emportent... ils
me traînent... ils m'éreintent !
je rabote le couloir !... comme
ça en pleine prise de membres...
On passe devant une baie
ouverte... l'endroit du grand
salon tout sombre !... Qui
est-ce que j'aperçois ?... là au
fond, tout pâles... tout
fantômes... absolument sur le
noir ?... " Pouce ! Pouce ! "...
que je crie à mes brutes... à
ces lâches qui me pancracent
disloquent...
Ho ! là ! Garde à vous ! Je les vois !... Tous je les vois !... Là-bas !
au fond !... Les vieux amis !...
debout sur le noir là !... fixes
!... Tous en chœur
un... deux... trois... cinq...
six !... debout dressés ! Salut
! que je leur crie ! Salut ! Ohé
! les hommes ! bonjour à tous
!... Debout les braves !... Je
les voyais absolument ! Ah ! pas
d'erreur !
 Fixes
là ! tels quels ! Nestor pas
grand dans le fond de la
pièce... sa grosse tête coupée
dans ses mains !... qu'il la
portait sur son ventre !... un
mac du Leicester !... qu'était
parti la semaine d'avant !... Et
le Gros-Lard à côté !... et
Fred-la-Moto !... et
Pierrot-Petits-Bras !... Et
Jojo-Belle-Bise !... Et
René-les-Clous !... celui-là le
ventre alors grand ouvert !...
Ils saignaient tous de quelque
part !... C'était ça le curieux
!... Et Lucien Galant et Muguet
!... Tue-Mouche en infanterie de
marine !... et Lu Carotte en
artilleur !... tout ça aligné
impeccable dans le fond du salon
! au plus sombre... Ils disaient
rien !... tous là debout !... en
uniforme mais la tête nue... Ils
étaient tous pâles de figure
!... blancs... blancs... comme
d'un reflet blême sous la
peau... une lueur... Fixes
là ! tels quels ! Nestor pas
grand dans le fond de la
pièce... sa grosse tête coupée
dans ses mains !... qu'il la
portait sur son ventre !... un
mac du Leicester !... qu'était
parti la semaine d'avant !... Et
le Gros-Lard à côté !... et
Fred-la-Moto !... et
Pierrot-Petits-Bras !... Et
Jojo-Belle-Bise !... Et
René-les-Clous !... celui-là le
ventre alors grand ouvert !...
Ils saignaient tous de quelque
part !... C'était ça le curieux
!... Et Lucien Galant et Muguet
!... Tue-Mouche en infanterie de
marine !... et Lu Carotte en
artilleur !... tout ça aligné
impeccable dans le fond du salon
! au plus sombre... Ils disaient
rien !... tous là debout !... en
uniforme mais la tête nue... Ils
étaient tous pâles de figure
!... blancs... blancs... comme
d'un reflet blême sous la
peau... une lueur...
- Ohé ! les
hommes, que je les rappelle !
ohé ! les hommes !... ohé !
enflures !... ohé ! la classe
!... ça boume là-dedans ?...
Ils répondent rien... Ils bougent pas !...
- Ils sont gelés merde !...
J'entraîne tout le monde après moi !... Je veux aller leur parler moi-même
! leur parler de tout près
!...comme ça dans la tronche...
Ah ! ils ont beau m'agripper
!... je suis plus fort que tout
! Ils me les tordent !... je
hurle !... au moins quatorze
bureaucrates !... et deux...
trois vieilles filles !... qui
m'attrapent au vif les parties
!... mes forces décuplent !...
tout le personnel !... les
huissiers !... je les entraîne !
Toute la grappe humaine !...
vers le fond !... le noir !...
Je veux parler moi à ces potes
!... où ils se tiennent là tout
saignants !... là tout pâles...
au garde à vous... Je veux les
toucher !...
Ça y
est !... Je les touche !... Ils
y sont plus !... Zut !... C'est
un monde !... Je le crie tout
haut !... l'Imposture !... C'est
de la misère de vache encore
!... Ils se sont enfuis !...
évaporés !... Tant pis pour eux
merde !... ils payeront !... Ils
trouveront personne au grand
Trou !... C'est tout de la
viande de perdition !... Je les
avais tous bien reconnus !...
Tous les copains du Leicester
!... Ils m'avaient bien vu moi
aussi !... Ils étaient disparus
tels quels !... Leurs boyaux
autour de la taille... dans le
fond de la pièce du Consulat
!...
- Allez,
descendez !... descendez !...
Sortez-le d'ici !...
Voilà comme on me traite ! Comme les huissiers font leur devoir ! Ah !
mais c'est la lutte ! Moi je
veux rester là par terre,
songer, réfléchir. Je me jette
sous un banc. Ils me rattrapent,
m'arrachent, disloquent. Ah !
ils sont trop en colère ! Je les
ai trop poussés à bout ! Même le
major si bienveillant...
Personne n'a plus un brin de
patience !... Ils me chargent
tous ensemble en même temps !...
Tous les employés du Consul !...
tous furieux alors, hommes,
femmes, demoiselles !... Je
bascule ! je roule ! je
m'écroule !... je m'abats plomb
en bas de l'escalier !... " Vive
la France !... que je hurle
quand même !... Vive le Consul
!... Vive Bedford Square !...
Vive l'Angleterre !... "
(Guignol's band, Folio, 1972, p. 300).
*********
Et aussi
Freud.
Au
fond, mon livre, c'est, en bien
des endroits, une sorte de
reportage comme on en trouve
dans les magazines. Et même,
est-ce bien du reportage ? Les
souvenirs des choses que j'ai
vues dans ma vie ne comptent pas
tant que cela. Ce ne sont que
des points de départ, des
prétextes qui me fournissent
l'occasion de noter mes rêves.
Car si la littérature a une
excuse (je crois bien d'ailleurs
que nous arrivons à la fin de la
littérature ; mais après tout,
peut-être ai-je tort de vous
dire cela : quand on a quelque
succès dans un genre, on est
toujours tenté de croire que ce
genre-là va disparaître parce
qu'on voudrait se persuader
qu'on a été un des seuls à y
réussir) ; si la littérature
donc a une excuse, c'est de
raconter nos délires.
Le délire,
il n'y a que cela et notre grand
maître actuellement à tous,
c'est Freud. Peut-être, si vous
tenez absolument à me trouver
d'autres influences plus
littéraires, peut-être que vous
pourriez indiquer les livres de
Barbusse.
(Interview avec Charles Chassé, Cahiers Céline 1, Gallimard, mai 1985,
p.88).
*********
Le style du délire.
Sachant l'ultime vanité du délire, Céline ne s'interdit pas de le rechercher. Il prescrit même de s'en satisfaire, si l'on peut.
Comme la vie n'est qu'un délire tout bouffi de mensonges, plus qu'on est loin et plus qu'on peut en mettre dedans des mensonges et plus alors qu'on est content, c'est naturel et c'est régulier. La vérité c'est pas mangeable (p.362).
A cette étape de la lecture de Voyage au bout de la nuit, l'attention se fixe sur le mot délire, qui se révèle un des fils conducteurs de l'ouvrage. Il apparaît obstinément au cours des pages, thème central de la méditation, lié à celui de la décrépitude et de la nécessité : La meilleure des choses à faire, n'est-ce pas, quand on est dans ce monde, c'est d'en sortir ? Fou ou pas, peur ou pas (p.65).
Et où aller dehors, je vous le demande, dès qu'on n'a plus en soi la somme nécessaire de délire ? (p.202).
J'étais prêt à toutes les résolutions du sommeil maintenant que j'avais absorbé un peu de cet admirable délire de l'âme (p.203).
Mais : " délire des uns ne fait pas du tout le bonheur des autres et chacun ici-bas se trouve indisposé par la marotte du voisin. " (p.280). Ainsi donc le délire est ambivalent, à la fois ce qui permet de vivre, malgré tout, et composante du malheur de l'homme, puisque le monde est une somme de délires qui se heurtent. Le malheureux parfait, le paria, c'est celui qui n'est pas délirant, ou chez qui le délire n'est que passager, instable, celui chez qui le délire ne parvient pas à se coaguler en " idée directrice " de la vie, à orienter un projet global. Tous les délires des autres se liguent pour le détruire. se heurtent. Le malheureux parfait, le paria, c'est celui qui n'est pas délirant, ou chez qui le délire n'est que passager, instable, celui chez qui le délire ne parvient pas à se coaguler en " idée directrice " de la vie, à orienter un projet global. Tous les délires des autres se liguent pour le détruire. Les heureux, par contre, sont les délirants parfaits. Plus on est fou plus on rit. C'est pourquoi les asiles d'aliénés jouent un tel rôle dans le Voyage : lieux bénis où les vrais fous entre eux, protégés du monde agité de délires plus meurtriers, peuvent coïncider pleinement avec leurs divagations. La véritable catastrophe, qui menace toujours, c'est la retombée du délire, la perte de l'illusion globale. Mort à crédit est une constellation de délires. Aussi tout le monde y est-il heureux, malgré les apparences, sauf le jeune narrateur, insuffisamment doué d'illusions, abruti de malheurs, contre qui tous les délirants s'acharnent à la poursuite des chimères qui constituent pour eux la seule réalité. Délire paternel transformant en Néron domestique ce minable petit employé, délire maternel qui sublime l'échec commercial en sainteté du petit commerçant, délire de Courtial qui transforme le monde en un Concours Lépine gigantesque, pour ne citer que les divagations qui marquent le plus profondément l'éducation de Ferdinand. Le délire est la raison de vivre de ces personnages, ce que le suicide de Courtial démontre : finalement désabusé, celui-ci ne peut survivre à ses illusions catastrophiques et indispensables.
Dans ce roman, Céline met au point le style du délire, et par la même occasion se suicide en tant que romancier. Commentant son œuvre sur la fin de sa vie, Céline s'attache presque uniquement à son aspect stylistique, sentant confusément que le style en est la clé. Il a inventé un style qu'il définit comme émotif, fondé sur une transposition du langage parlé. Il lui arrive de condamner le Voyage encore plein de phrases filées, " Paul Bourget " plus qu'à moitié. On peut dire que le style du délire tel qu'il envahit Mort est bien une espèce de " style parlé ", puisqu'il est placé dans la bouche de personnages. Cependant, on ne " cause " pas dans Mort à crédit. Les personnages hurlent, se plaignent, vitupèrent, gémissent, et n'admettent jamais la réplique. Ils sont enfermés dans une divagation qui ne recherche pas l'authenticité, qui la fuit du plus loin. Les monologues se poursuivent dans des univers parallèles, entre lesquels circulent seuls des signaux de déclenchement. Un mot met en branle la tirade que rien ne pourra plus arrêter. (...) Il reste à voir que même à son paroxysme, même aux sommets où le délire semblait le plus authentique, au moment où se posait sérieusement la question de la folie de Céline, le délire est resté parodique, révélant une distance entre la divagation et l'auteur, qui dans le même moment où il déraille ne peut pas se prendre totalement au sérieux, fausse folie et vraie en même temps, comédie paradoxale mais nécessaire. C'est en ceci que nous pourrions voir un Céline pascalien à demi, puisque pour échapper à l'horreur de la condition humaine l'homme conscient doit ou se divertir ou faire les gestes de la foi. Pascalien incomplet mais profondément de son siècle puisque l'agenouillement, l'abêtissement restent sans objet et que le chercheur de foi s'entête tout en se sachant ridicule.
L'irrationnel reste pour Céline la seule raison d'être, le seul mode de vie possible entre l'espoir pour tous les hommes qu'il ne peut concevoir, et le suicide qui lui fait horreur - incapable de faire confiance à l'homme et de concevoir Dieu, son cri se perd dans un grincement qui reste trop humain pour ne pas nous faire trembler, nous renvoyer vers notre miroir.
(Michel Beaujour, La quête du délire, Les cahiers de l'Herne, Poche-Club, 1968, p. 242).
*********
Le maudit curé ou Vaudremer le médecin quatre galons... Je me couche et j'attends... pas long ! Je secoue mon page !... un frisson !... deux !... toujours lucide je me dis : ça y est !... ce pristi maudit boueux curé m'a fait attraper la crève !... je le savais en l'écoutant !... je voulais pas y aller !... certain aussi que j'allais délirer, l'accès !... délire vous passe le temps... mais délirer est délicat devant des personnes... vous pouvez regretter vos paroles... puisqu'il s'agit d'un paludisme que je traîne depuis quarante ans, depuis le Cameroun, vous pensez que je suis pas surpris... ce coup de cureton, sous la flotte, trempé à l'os, au vent du nord, à écouter ses sornettes, ça allait de soi !... si c'était tout !... mais non !... mais non !... autre chose dans le coin... à la porte... je suis sûr, quelqu'un d'assis... je vais pas allumer... bouger... c'est peut-être seulement l'effet de la fièvre ! l'autre aussi a parlé de Noël... peut-être une idée, et la fièvre... un intrus ?... tout se peut !... ce foutu ratichon est bien venu sonner... peut-être revenu ?... je jurerais pas... en tout cas dans le coin là, quelqu'un... je vais pas y aller... je tremble et transpire... quelqu'un ?... quelque chose ?... assez à faire !... l'esprit demeure, remarquez... je considère... oui ! mieux ! verdâtre ce quelqu'un, assis... une lumière de ver luisant... j'ai bien fait d'attendre... ces apparitions ne durent pas... je le vois maintenant presque... c'est un militaire... il vient me parler ? qu'il parle !... j'attends... il parle pas, il bouge pas... assis... verdâtre...
- Alors ?... alors ?
Je questionne... je tremble... Oh ! il me fait peur !... bigre mais c'est lui !... je le connais... je le connais ! là, verdâtre... luisant... plus ou moins...
- Vaudremer !
Je l'appelle... il répond rien... il est là pourquoi ? pour Noël ?... comme le ratichon ?... il est passé par la grille ?... à travers ?... les chiens n'ont pas aboyé... bizarre  frasque !... ce Vaudremer je l'ai connu médecin quatre galons... c'était où ?... vous pensez un peu la mémoire dans mon état de fièvre, sudation, saccades de tout le page... j'ai le droit de ne pas être sûr... surtout qu'il ne m'aidait pas du tout... je hausse le ton... je me force, vous remarquez... frasque !... ce Vaudremer je l'ai connu médecin quatre galons... c'était où ?... vous pensez un peu la mémoire dans mon état de fièvre, sudation, saccades de tout le page... j'ai le droit de ne pas être sûr... surtout qu'il ne m'aidait pas du tout... je hausse le ton... je me force, vous remarquez...
- Vaudremer !... semi-lumineux !... je vous somme !... qu'est-ce que vous me voulez ?... vous êtes là ?... oui ?... non ?... revenant d'où... Il ne bouge pas... je vois pas sa figure... mais ! c'est lui... nous consultions là-bas ensemble... lui médecin-chef... il se faisait drôlement insulter d'une baraque l'autre... l'esprit était détestable... tous les ménages se plaignaient qu'ils avaient froid, qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif, tout le personnel S.N.C.A.S.O., campé en baraques Adrian ! ouvriers, maîtrise, ingénieurs, et les infirmiers... que c'était la honte !... que nous médecins étaient criminels, ennemis du peuple, réactionnaires, que nous avions tout préparé, les stukas, la cinquième colonne, le trust des denrées, que les pauvres gens meurent de faim et d'épidémies... que nos soi-disant médicaments étaient bel et bien des poisons... la preuve que personne pouvait plus aller aux gogs (trois enfants noyés) tellement les feuillées débordaient, que c'était la brune inondation, par les coliques, pisseries, dues à nos soi-disant remèdes... que la diarrhée générale submergerait tout... que les boches de Saint-Jean-d'Angely avaient leur tactique, tous leurs tanks en position pour nous refouler tous dans la merde qu'on meure tous, bouge plus, sous au moins un mètre d'excréments, si on faisait mine d'échapper... Comment ils avaient fini ? je me demande ! une chose nous fûmes épargnés, Lili, moi, Bébert, en raison de notre ambulance... notre ? non ! celle de Sartrouville, que j'avais amenée jusque-là... le parcours dont on ne parle jamais dans les annales de l'Epopée... " La Seine-La-Rochelle " !... et avec quel mal !... pas que moi et Lili, une grand-mère et deux nourrissons ! j'avais dû les laisser en plan sur la grande place de La Rochelle... vous me direz : des inventions ! pas du tout !... la preuve, la môme, la plus petite je me souviens encore de son nom : Stéfani !... elle doit être mariée à présent et mère de famille... au moment là elle avait un mois, tout au plus... le général commandant la place, général français, voulait que nous embarquions pour Londres avec la bouzine, et la grand-mère et les mômes, certes c'était tentant !... ma fortune prenait un autre tour, quel héros je serais à l'heure actuelle ! quelles stèles et quelles rues à mon nom !
- Mon général ! non ! je refuse ! tout mon respect et mille regrets, mon général ! consigne d'abord ! ces nourrissons et la grand-mère, très alcoolique, appartiennent à Sartrouville ! avec la bouzine !... je dois tout remonter à Sartrouville !
- Parfait ! disposez docteur ! Je ne suis pas revenu au camp Adrian, si fétide... adieu Saint-Jean-d'Angely !... je n'ai jamais su s'ils avaient fini sous les tanks... ou sous les diarrhées... Je n'ai jamais revu Vaudremer... pourtant n'est-ce pas c'est bien lui, il était là, assis, ne disant mot... et fluorescent !... je vais l'interpeller à la fin !... non !... je ne peux pas... une chose, j'oublie !... je vous ai dit je m'embarquais avec joie pour Londres... vous direz il nous affirme ça pour les besoins de la circonstance, pour avoir l'air résistant... que non ! mais non ! j'ai des raisons et pas d'hier, d'être anglophile... bien plus que ceux qui y ont été ! je pense à ce général qui m'offrait... je pense à ce fantôme de Vaudremer là, fluorescent, assis... enfin l'espèce de fantôme... et je sais que m'en vais... oh pas n'importe où !... ici même l'espèce de Vaudremer s'éteint... il s'éteint parce que les chiens hurlent... ouah !... vraiment les chiens... pas que du rêve !... je dégouline transpire, je grelotte encore fort, mais c'est la fin... depuis trente ans que je pique des accès, je sais comment ils finissent... et aussi leurs façons d'attaque... ce coup-ci c'est ce foutu ratichon qui m'a tenu à la grille... j'aurais pas dû l'écouter... ouah !... ouah !... maintenant là qui c'est ?... Lili et les chiens... elle allume... toutes les lampes... elle a pas peur...
- Tu parlais avec quelqu'un ?
- C'était Vaudremer...
Elle insiste pas... elle croit que je divague encore...
(Rigodon, Folio, Gallimard,1973, p.35).
*********
Ce n’est pas un hasard si Mort à crédit débute
sur une mort, justement. La mort de la concierge. Les
quelques pages d’ouverture balancent entre une misère
irrespirable et la tentation, pour le récitant, de la
fuir. De la fuir comment ? Essentiellement par le
délire.
Ce délire mérite d’être défini. Il y a en lui quelque
chose d’évidemment clinique. Le délire est d’abord une
maladie – et l’une des plus horribles qu’il soit. Il
débouche sur la folie – ce stade limite de la misère. Ce
n’est pas tout. Le délire exprime la souffrance, mais il
est aussi un moyen psychologique pour y échapper.
Le délirant perd le contact avec la réalité
quotidienne et atroce du monde. Il n’en a plus
conscience. Il la fuit. Bref, comme tous les autres
types de parole célinienne – parole de distraction,
parole cynique pour améliorer son état, parole naïve
pour corriger le monde - , la parole de délire a pour
objet de remédier à la misère après en avoir été la
conséquence (on délire sous la pression d’une fièvre,
d’une douleur), mais cette ambition est vaine puisque
cette parole la redouble, elle aussi, la misère.
Connaît-on une horreur plus grande que celle d’un
asile ?
Ce n’est pas encore tout. Ce délire qui happe Bardamu
et Ferdinand les hausse sur un plan de réalité
supérieure. Tout se passe comme s’ils prenaient alors
conscience des vraies valeurs du monde. Les apparences
se dépouillent – et voilà les héros livrés à une
appréhension exacte des injustices, des souffrances et
des fatalités qui les assaillent. Nous n’en donnerons
qu’un seul exemple.
Au début de Voyage au bout de la nuit, Bardamu
déclare à son ami Arthur Ganate : On est tous assis
sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu
peux pas venir me dire le contraire !... Assis sur des
clous même à tirer tout nous autres ! Et qu’est-ce qu’on
en a ? Rien ! Des coups de trique seulement, des
misères, des bobards et puis des vacheries encore.
Plus tard, à la fin de son séjour africain,
grelottant de fièvre, Bardamu se met à délirer. Il se
voit victime d’une universelle conspiration. Il rêve son
voyage aux Etats-Unis à bord d’une immense galère.
Episode onirique ? Episode mensonger ? Non ! Cette
galère est vraie. Vraie comme le délire célinien
qui a pour fonction de faire simplement glisser une
vérité métaphorique (la galère du début) vers une
réalité physique (la galère vers l’Amérique),
pulvérisant ainsi les apparences raisonnables pour mieux
rejoindre l’on ne sait quelle vérité essentielle.
C’est exactement de cette façon qu’il faut comprendre
l’ouverture de Mort à crédit. Le narrateur est
sujet à des hallucinations. Tout conspire contre lui. Il
entend des bruits épouvantables. Rêveries érotiques
aussi…
C’était l’enfer…
Et voilà que le récit de son enfance surgit de ce
délire, qu’il s’affirme en somme comme le produit de
cette parole de délire. Enfance rêvée, déformée et
profondément exacte, enfance racontée pour fuir une
misère présente, pour renoncer un temps à la pratique
médicale.
Ainsi Céline caractérise-t-il précisément son
écriture, nous y reviendrons… En écrivant, il s’enferme
dans l’espace de la plus grande lucidité et des plus
grandes illusions. Il se dérobe devant la vie et se
permet pourtant de la retrouver dans sa vérité la plus
palpitante. L’espace littéraire est celui de la mise à
l’écart du monde, mais il est aussi un espace de mise au
silence, un lieu de grande clairvoyance.
Céline le délirant…
(Frédéric Vitoux, Céline, les dossiers Belfond 1987,
p.144).
*********
Les réalités ou les visions délirantes ?
Et que
dire de Féerie pour une autre fois ou de Normance où l’histoire s’efface davantage encore
derrière les images ? Céline délire, d’une écriture qui
va s’inventant maintenant son propre lexique.
Avec
Casse-Pipe, il bénéficiait encore d’un
certain recul. Recul déjà moindre dans Guignol’s Band.
Avec Féerie ou Normance, Céline parle
quasiment au présent. Il évoque le Paris de la fin de
l’Occupation alors que résonne encore le fracas des
bombes. Il écrit pour en chasser le souffle. Il écrit
par horreur de la réalité et sur cette horreur de la
réalité. Il écrit sur ce qu’il vit – et ces livres nous
paraissent comme le cauchemar d’une seule nuit. Aucun
repère ne résiste. Le lecteur ne sait plus sur quoi
s’appuyer. Les représentations s’effondrent : Paris
s’enflamme, la butte Montmartre croule sur elle-même. La
parole célinienne est une parole de fin du monde. La
chute d’un corps dans l’escalier d’un appartement de la
rue Girardon, ralentie à l’extrême, finit par en devenir
abstraite. C’est une chute d’apocalypse. On tombe
aussi dans une parole si saccadée qu’elle arrive à ne
plus s’exprimer que par ses seuls silences.
La colère de Bagatelles pour un massacre est bien une colère
individuelle, une haine personnelle et revendiquée comme
telle. C'est parce qu'il n'a pas réussi à l'opéra que
Céline se venge des juifs responsables de ses
déconvenues. C'est parce que les critiques juifs ou
enjuivés ont attaqué ses livres qu'il leur règle leur
compte. C'est parce qu'il n'a pas fait carrière à la
S.D.N. qu'il dénonce les complots des juifs. Tous ces
motifs sont ici reconnus. Ensuite seulement
surgissent les considérations générales, les leçons
politiques que Céline tire de ses propres déboires.
Des leçons dont la déraison ou le délire se trouvent ainsi expliqués par
l'emportement de l'auteur blessé lui-même par ces maux
qu'il dénonce. Racine, le pape, la reine d'Angleterre et
les Bourbons, soupçonnés d'être juifs, se trouvent
charriés dans un torrent d'invectives. La grossièreté
inouïe, la vulgarité résolue des attaques, la fantaisie
de l'érudition, les fausses citations et les
statistiques inventées, tout cela participe de la même
folie qu' " excuse " la folie d'un individu, d'un malade
sujet à un délire chronique de persécution.
C'est bien Guignol's Band qui a fourni à Céline
les décors les plus poétiques mais surtout les plus
accordés à ses sentiments et à sa morale. Les plus
exacts en un mot. (...) On ne sait jamais très bien chez
Céline, ce qui ressortit au détail réaliste ou sordide
et à la vision délirante ou heureuse. Le Londres de
Guignol's Band trahit cette dualité. Un peu comme le
Sigmaringen de D'un château l'autre. Il recèle
les misères les plus atroces. Mais c'est aussi un cadre
d'opérette.
Ainsi la maison de Van Claben :
Une maison située admirable, tout un théâtre devant ses fenêtres,
prodigieux décor de verdure sur le plus grand port du
monde... Tout de suite à la belle saison ça devenait une
vraie magie... fallait voir un peu les massifs, ce
déferlement de fleurs !... Douceur éperdue de nature, un
épanouissement du bocage à faire éclater les cimetières
! à faire rigodoner les cierges !... J'ai vu cela ! je
peux causer !...
Et c'est dans cette maison, précisément, que se déroulent certains
des évènements les plus atroces et les plus improbables
: bagarres sans merci, ivresse, mort de Van Claben,
incendie... Il suffit pourtant que Borokrom se mette au
piano et joue quelques mesures de Jolly Dame Walz
pour qu'aussitôt le trivial se dissipe - ou s'oublie.
Lui pourtant loursingue de nature et franchement brutal et pénible
avec sa manie d'explosifs il devenait là tout voltigeur,
tout cascadeur, tout lutin !... Il avait l'esprit dans
les doigts... Des mains de fée !... des papillons sur
les ivoires... Il virevolait aux harmonies !... piquait
l'une et l'autre à l'envol !... songes et toquades !...
guirlandes... détours... fredaines prestes... Possédé
!... pas autre chose à dire... par vingt petits diables
dans les doigts !...
Mais on multiplierait, tout au long du récit, les exemples de passage
de l'horreur au délire, de la misère aux fantasmes, du
sordide au merveilleux : hallucinations de Ferdinand
croyant jeter sous une rame de métro l'un des hommes de
main de Cascade puis invectivant les employés du
consulat, emportements du héros devant Virginia...
Je suis oiseau !... Je virevole ! Oiseau de feu !... Je ne sais
plus... Je hurle !...
Ou encore cette longue séquence dans la boîte de nuit londonienne...
Certes, ce n'est pas la première fois que Céline opère de tels
glissements. L'épisode de la galère ou celui sur le roi
Krogold dans Mort à crédit participaient déjà de
ces changements de réalité. Ils restaient malgré tout
limités et repérables. Dans Guignol's Band, en
revanche, ils sont multiples et beaucoup plus fondus
dans l'ensemble de la narration. Dès lors, tout le livre
semble pris dans un curieux soupçon. Il se
présente comme un long délire. Un délire justifié par le
héros malade et réformé, sujet à névralgies et à
hallucinations, drogué parfois par d'étranges
cigarettes, et qui jette ici sur ses aventures
londoniennes un regard voilé d'incertitudes, de peurs,
de doutes.
Un regard malgré tout suffisamment déformant pour atténuer l'oppression
et la misère de la réalité. Un regard suffisamment
déformant, qui force les traits jusqu'à la caricature,
les évènements jusqu'à la comédie. Pour faire oublier en
somme l'atroce misère qui les sous-tend.
On
peut considérer en vérité Normance comme
constitué d'un gigantesque balancement entre une vérité
tragique : un bombardement sur Paris, et une maladie
personnelle : les bourdonnements et les " visions " du
romancier. Les hallucinations multiplient la portée et
l'ampleur du cataclysme observé. Mais ce cataclysme
redouble encore les névralgies, les spasmes, les délires
de Céline. Bientôt, tout se trouve emporté dans cette
accélération ambiguë où l'on ne sait jamais, à l'instar
du narrateur, à quel niveau de réalité se situer.
(Frédéric Vitoux, Céline, Les dossiers Belfond, 1987, p.197).
*********
Délire
des coulisses.
Dans D'un château l'autre, une fois de plus, il
est frappant de remarquer à quel point le passage du
présent au passé s'opère par le biais du délire.
Sigmaringen n'apparaît que lorsque Céline grelotte de
fièvre, qu'il voit Le Vigan surgir et onduler devant lui
(celui-ci, on le sait, ne revint jamais en Europe après
la guerre, il resta en Argentine où il mourut), et qu'il
rêve l'épisode de la barque des morts.
Tout se passe donc - toujours - comme si le seul délire avait le pouvoir
de dissiper la misère présente, de faire naître le récit
et d'éclairer la réalité d'un jour finalement plus juste
dans sa monstruosité fictive que les pâles chroniques
scrupuleusement respectées.
Le délire célinien, encore une fois, s'accorde au délire de la
représentation hitlérienne qui s'achève. Mais
c'est d'abord un délire inventé. Céline imagine
seulement le dîner chez Abetz au château de Sigmaringen.
On sait qu'il ne se rendit pas à l'enterrement de
Bichelonne, à Hohenlychen. Et pourtant les témoins de
cet enterrement s'accordent à juger la relation
célinienne de la cérémonie d'une justesse hallucinante -
dans sa propre invention déformée.
Il y a plus. C'est tout Sigmaringen, c'est toute l'Allemagne en flammes
qui apparaissent de prime abord fictifs - et cela
est aussi vrai de l'Allemagne de Nord et de Rigodon. Partout, on dirait une immense
illusion
: les villes embrasées comme les navires aux quilles
retournées, dans les ports. On connaît ces décors de
théâtre à deux dimensions - ambitieuses architectures de
toile peinte. Les cités écroulées, le Berlin de Nord
où seules les façades résistent encore et se dressent,
c'est exactement cela.
De Sigmaringen, Céline écrit :
... vous vous diriez en opérette... le décor parfait... vous attendez
les sopranos, les ténors légers... pour les échos, toute
la forêt ... dix, vingt montagnes d'arbres !...
Forêt Noire, déboulées de sapins, cataractes... votre
plateau, la scène, la ville, si jolie fignolée, rose,
verte, un peu bonbon, demi-pistache, cabarets, hôtels,
boutiques, biscornus pour " metteur en scène "... tout
style " baroque boche " et " Cheval Blanc "... vous
entendez déjà l'orchestre !... le plus bluffant : le
château !... la pièce comme montée de la ville... stuc
et carton-pâte !...
Ce
château relève encore de contes fantastiques,
avoue Céline
plus loin. Il a ses secrets, ses oubliettes, ses
tapisseries truquées et ses escaliers dérobés.
L'hôtel Löwen demeure tout aussi théâtral. Les portes claquent, les
couloirs résonnent. Il y a des allées et venues
incessantes. Des apparitions. Des disparitions. Comme
dans une comédie ou un conte de fées. L'hôtel a même son
ogre et son cabinet noir. L'ogre, c'est le S.S. von
Raumnitz. Le cabinet noir, cette chambre 36 où
s'engloutissent ses victimes...
Mais surtout règne la même folie. Dans la rue ou les gares. Tourbillons,
fausses sorties, trains qui ne vont nulle part. Sans
oublier cette Suisse comme un mirage, une glace à
laquelle on se heurte et qui vous refoule...
Cette Allemagne d'opérette garde quelque chose d'exemplaire. Son
mensonge est à la mesure exacte de l'univers
célinien. La misère y règne sans partage, et partout
elle est niée, occultée. Un monde meurt. Les souffrances
se multiplient. Tout s'écroule. Et que voit-on ? Un pays
dont les habitants - les anciens privilégiés -
s'efforcent de refuser l'histoire et de refuser la
réalité. Tous - soldats et officiers allemands,
collaborateurs déplacés, anciens dignitaires de Vichy -
s'apprêtent à devenir les vaincus et les victimes de
l'ordre nouveau qui se précise. Ils le savent peut-être.
Mais pour mieux l'oublier. Ils arrêtent le temps. Ils
mentent à la folie. Ils nient jusqu'à épuisement la
misère qui les frappe.
(...) On a souvent souligné le délire de persécution de Céline. Ce délire,
on peut le comprendre ainsi : l'auteur sait que, au-delà
de la représentation qu'ils lui donnent, les
êtres participent d'une réalité plus secrète et plus
cruelle. Et que derrière le théâtre souriant des
apparences (nous sommes en pleine plaisanterie,
écrira-t-il dans Nord) se cache l'univers
terrifiant et exact des coulisses.
L'Allemagne de la débâcle, l'enclave de Sigmaringen et son château lui
offrent l'une des plus belles scènes qui soient. Céline
en a développé tous les sortilèges, en ne cessant dans
le même mouvement de les dénoncer...
(Frédéric Vitoux, Céline, Dossiers Belfond, 1987, p.220).
*********
La peur du soldat.
-
Venez ! fit-elle alors... Vous dites des bêtises
Ferdinand, et nous allons attraper froid.
Nous descendîmes vers Saint-Cloud par la grande allée, la Royale, en
évitant la boue, elle me tenait par la main, la sienne
était toute petite, mais je ne pouvais plus penser à
autre chose qu'à la noce en zinc du Stand de là-haut
qu'on avait laissée dans l'ombre de l'allée. J'oubliais
même de l'embrasser Lola, c'était plus fort que moi. Je
me sentais tout bizarre. C'est même à partir de ce
moment-là, je crois, que ma tête est devenue si
difficile à tranquilliser avec ses idées dedans.
Quand nous parvînmes au pont de Saint-Cloud il faisait tout à fait
sombre.
- Ferdinand, voulez-vous dîner chez Duval ? Vous aimez bien Duval, vous...
Cela vous changera les idées... On y rencontre toujours
beaucoup de monde... A moins que vous ne préfériez dîner
dans ma chambre ? - Elle était bien prévenante, en
somme, ce soir-là.
 Nous nous décidâmes finalement pour Duval. Mais à peine
étions-nous à table que l'endroit me parut insensé. Tous
ces gens assis en rangs autour de nous me donnaient
l'impression d'attendre eux aussi que des balles les
assaillent de partout pendant qu'ils bouffaient.
Nous nous décidâmes finalement pour Duval. Mais à peine
étions-nous à table que l'endroit me parut insensé. Tous
ces gens assis en rangs autour de nous me donnaient
l'impression d'attendre eux aussi que des balles les
assaillent de partout pendant qu'ils bouffaient.
-
Allez-vous-en tous ! que je les ai prévenus. Foutez le
camp ! On va tirer ! Vous tuer ! Nous tuer tous !
On m'a ramené à l'hôtel de Lola, en vitesse. Je voyais partout la même
chose. Tous les gens qui défilaient dans les couloirs du
Paritz semblaient aller se faire tirer et les employés
derrière la grande caisse, eux aussi, tout juste faits
pour ça, et le type d'en bas même, du Paritz, avec son
uniforme bleu comme le ciel et doré comme le soleil, le
concierge qu'on l'appelait, et puis des militaires, des
officiers déambulants, des généraux, moins beaux que lui
bien sûr, mais en uniforme quand même, partout un tir
immense, dont on ne sortirait pas, ni les uns ni les
autres. Ce n'était plus une rigolade.
- On va tirer ! que je leur criais moi, du plus fort que je pouvais, au
milieu du grand salon. On va tirer ! Foutez donc le camp
tous !... Et puis par la fenêtre que j'ai crié ça aussi.
Ça me tenait. Un vrai
scandale. " Pauvre soldat ! " qu'on disait. Le concierge
m'a emmené au bar bien doucement, par l'amabilité. Il
m'a fait boire, et j'ai bien bu, et puis enfin les
gendarmes sont venus me chercher, plus brutalement eux.
Dans le Stand des Nations, il y en avait aussi des
gendarmes. Je les avais vus. Lola m'embrassa et les aida
à m'emmener avec leurs menottes.
Alors je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu'ils ont expliqué à
l'hôpital, par la peur. C'était possible. La meilleure
des choses à faire, n'est-ce pas, quand on est dans ce
monde, c'est d'en sortir ? Fou ou pas, peur ou pas.
(Voyage au bout de la nuit, Livre de poche, 1956, p.64).
*********
De l'expropriation.
On
parlait même encore bien plus de nous démolir
complètement ! de démonter toute la galerie! De faire
sauter notre grand vitrage ! oui ! Et de percer une rue
de vingt-cinq mètres à l'endroit même où nous logions...
Ah ! Mais c'était pas des bruits sérieux, c'était plutôt
des balivernes, des racontars de prisonniers. Cloches
!... Sous cloche qu'on était ! sous cloche qu'il fallait
demeurer ! Toujours et quand même ! Un point c'était
tout !... C'était la loi du plus fort !...
De temps à autre, faut bien comprendre, ça venait à fermenter un peu dans
la bobèche des miteux, des drôles de mensonges, comme ça
sur le pas des boutiques, surtout les jours de
canicule... Ça venait comme
des bulles dans leur bourrichon crever en surface...
avant les orages de septembre... Alors, ils se montaient
des bobards, des entourloupes monumentales, ils rêvaient
tous de réussites, de carambouilles formidables... Ils
se voyaient expropriés, c'était des fantasmes !
persécutés par l'Etat ! Ils ballonnaient, ils se
détraquaient la pendule, complètement bluffés, soufflés
de bagornes... eux qu'étaient pâlots d'habitude ils
tournaient au cramoisi...
Avant d'aller roupionner, ils se passaient des devis
mirifiques, tout des mémoires imaginaires ! des sommes
écrasantes à la fois, absolument capitales qu'ils
exigeraient d'un seul coup dès qu'on parlerait de
déménager ! Ah là là ! Eh ben Nom de Dieu ! ils en
auraient du tintouin ! les suprêmes Pouvoirs Publics,
pour les faire barrer d'ici !... Ils soupçonnaient pas
encore les Conseils d'Etat !... Comment c'était la
Résistance ! Ouais ! Tout le Bastringue et la
Chancellerie !... Ah ils en baveraient cinq minutes !
Ils en auraient à qui causer ! Yop ! Et des Ecritures et
des Sommations consortieuses !... Tout ça et bien pire
encore ! Par les trente deux mille morpions !
Ça ronflerait dur !
Ça se ferait pas trou du cul
tout seul !... Qu'on leur passerait sur le corps... qu'ils
s'enfouiraient dans la turne ! On serait forcé
finalement d'éventrer toute la Banque de France pour
leur faire une vraie boutique ! la même au poil ! Au
milligramme ! A deux décimes ! Très exactement ! Rien
d'autre ! Ou rien alors ! Basta ! Rencard ! Ils se
buteraient définitif !... Encore à la pire extrême ils
accepteraient la grande rente... Ils diraient pas non...
Ils voudraient peut-être bien... Ah ! mais la définitive
! La rente pour la vie Nom de Dieu ! Une replète, une de
Banque de France formidablement garantie qu'on
dépenserait à volonté ! Ils iraient pêcher à la ligne !
Peut-être pendant quatre-vingt-dix ans ! Et puis des
bringues nuit et jour ! Et ça serait pas encore fini !
Et qu'ils auraient encore des " droits " avec des
invincibles " reprises " et des maisons à la campagne et
puis des autres indemnités... qu'étaient même pas
calculables !
Alors ? C'était qu'une question de caractère ! C'était
simple, irréfutable ! Il fallait pas céder jamais !
Ainsi qu'ils voyaient toutes les choses... C'était
l'effet des chaleurs, de la terrible atmosphère, des
effluves d'électricité... une façon de pas
s'engueuler... En s'entendant bien sur les " reprises
"... Tout le monde était dans l'accord... Tout le monde
se fascine pour l'avenir... Chacun veut qu'on
l'exproprie.
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.329).
*********
La musique ou la mort
dans l'oreille.
Ma
mère et Madame Vitruve, à côté, elles s'inquiétaient,
elles allaient et venaient dans la pièce en attendant
que ma fièvre tombe. Une ambulance m'avait rapporté. Je
m'étais étalé sur une grille avenue Mac-Mahon. Les flics
en roulette m'avaient aperçu.
Fièvre ou pas, je bourdonne toujours et tellement des deux oreilles que
ça peut plus m'apprendre grand'chose. Depuis la guerre
ça m'a sonné. Elle a couru derrière moi la folie... tant
et plus pendant vingt-deux ans. C'est coquet. Elle a
essayé quinze cents bruits, un vacarme immense, mais
j'ai déliré plus vite qu'elle, je l'ai baisée, je l'ai
possédée au " finish ". Voilà ! Je déconne, je la
charme, je la force à m'oublier.
Ma grande rivale c'est la musique, elle est coincée, elle se détériore
dans le fond de mon esgourde... Elle en finit pas
d'agonir... Elle m'ahurit à coups de trombone, elle se
défend jour et nuit. J'ai tous les bruits de la nature,
de la flûte au Niagara... Je promène le tambour et une
avalanche de trombones... Je joue du triangles des
semaines entières... Je ne crains personne au clairon.
Je possède encore moi tout seul une volière complète de
trois mille cent vingt-sept petits oiseaux qui ne se
calmeront jamais... C'est moi les orgues de l'Univers...
(...)
Je pensais à tout ça dans ma crèche, pendant que ma mère
et Vitruve déambulaient à côté.
La porte de l'enfer dans l'oreille c'est un petit atome de rien. Si on le
déplace d'un quart de poil... qu'on le bouge seulement
d'un micron, qu'on regarde à travers, alors c'est fini !
c'est marre ! on reste damné pour toujours ! T'es prêt ?
Tu l'es pas ? Etes-vous en mesure ? C'est pas gratuit de
crever ! C'est un beau suaire brodé d'histoires qu'il
faut présenter à la Dame. C'est exigeant le dernier
soupir. Le " Der des Der " Cinéma ! C'est pas tout le
monde qu'est averti ! Faut se dépenser coûte que coûte !
Moi je serai bientôt en état... J'entendrais la dernière fois mon toquant
faire son pfoutt ! baveux... puis flac ! encore... Il
branlera après son aorte... comme dans un vieux
manche... Ça sera terminé.
Ils l'ouvriront pour se rendre compte... Sur la table en
pente... Ils la verront pas ma jolie Légende, mon
sifflet non plus... La Blême aura déjà tout pris...
Voilà Madame, je lui dirai, vous êtes la première
connaisseuse !...
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.38).
*********
La grande cliente...
J'ai toujours eu la grosse tétère, bien plus grosse
que les autres enfants. Je pouvais jamais mettre leurs
bérets. Ça lui est revenu
d'un coup à maman, cette disposition monstrueuse... à
mesure que je dégobillais... Elle se tenait plus
d'inquiétude.
" Vois-tu Auguste, qu'il aille nous faire une méningite ? Ce serait bien
encore notre veine !... Il nous manquait plus que ça
comme tuile !... Alors vraiment ça serait le bouquet
!... " A la fin j'ai plus rendu... J'étais confit dans
la chaleur... Je m'intéressais énormément... Jamais
j'aurais cru possible qu'il me tienne autant de trucs
dans le cassis... Des fantaisies. Des humeurs
abracadabrantes. D'abord j'ai vu tout en rouge... Comme
un nuage tout gonflé de sang... Et c'est venu dans le
milieu du ciel... Et puis il s'est décomposé... Il a
pris la forme d'une cliente... Et alors d'une taille
prodigieuse !... Une proportion colossale... Elle s'est
mise à nous commander... Là-haut... En l'air... Elle
nous attendait... Comme ça en suspens... Elle a ordonné
qu'on se manie... Elle faisait des signes... Et qu'on se
dégrouille tous !... Qu'on s'échappe vivement du
Passage... Et dare-dare !... Et tous en cœur
!... Y avait pas une seconde à perdre !
Et puis elle est redescendue, elle s'est avancée sous le
vitrail... Elle occupait tout notre Passage... Elle
pavanait en hauteur... Elle a pas voulu qu'il en reste
un seul boutiquier en boutique... un seul des voisins
dans sa turne... Même la Méhon venait avec nous. Il lui
était poussé trois mains et puis quatre gants enfilés...
Je voyais qu'on partait s'amuser. Les mots dansaient
autour de nous comme autour des gens du théâtre... Des
vives cadences, des imprévus, des intonations
magnifiques... Des irrésistibles...
De nos dentelles, la grande cliente elle s'en est fourré plein les
manches... Elle les fauchait à pleine vitrine, elle
essayait pas de se cacher, elle s'est recouverte de
guipures, des mantilles entières, d'assez de chasubles
pour recouvrir vingt curés... Elle se grandissait à
mesure dans les frous-frous et les ajours...
 Tous
les petits vauriens du Passage... les revendeurs en
parapluies... Visios aux blagues à tabac... les
demoiselles du pâtissier... Ils attendaient... Madame
Cortilène la fatale, elle était là à côté de nous... Son
révolver en bandoulière, rempli de parfums... Elle
vaporisait tout autour... Madame Gounouyou, des
voilettes, celle qui restait enfermée depuis tant
d'années à cause de ses yeux chassieux, et le gardien
tout en bicorne, ils se concertaient à présent, comme
avant une fête, nippés sur leur 31 et le petit Gaston
lui-même, un des petits relieurs décédés, il était
revenu tout exprès, il tétait justement sa mère. Sur ses
genoux bien sage, il attendait qu'on le promène. Elle
lui gardait son cerceau. Tous
les petits vauriens du Passage... les revendeurs en
parapluies... Visios aux blagues à tabac... les
demoiselles du pâtissier... Ils attendaient... Madame
Cortilène la fatale, elle était là à côté de nous... Son
révolver en bandoulière, rempli de parfums... Elle
vaporisait tout autour... Madame Gounouyou, des
voilettes, celle qui restait enfermée depuis tant
d'années à cause de ses yeux chassieux, et le gardien
tout en bicorne, ils se concertaient à présent, comme
avant une fête, nippés sur leur 31 et le petit Gaston
lui-même, un des petits relieurs décédés, il était
revenu tout exprès, il tétait justement sa mère. Sur ses
genoux bien sage, il attendait qu'on le promène. Elle
lui gardait son cerceau.
(...) A mesure qu'on avançait, qu'on suivait la grande cliente, on était
de plus en plus nombreux, on se bigornait dans son
sillon... Et la dame grandissait toujours... Elle était
forcée de se courber pour pas défoncer notre vitrail...
L'imprimeur aux cartes de visite, il a bondi hors de sa
cave, juste au moment où nous passions, il trimbalait
ses deux chiards, devant lui, dans une petite voiture,
et des pas très vivants non plus... emmitouflés en
billets de banque... Rien que des cent francs... Rien
que des faux... C'était sa combine... Le marchand de
musique du 34, qui possédait un gramophone, six
mandolines, trois cornemuses et un piano, il voulait
rien abandonner... Il a voulu tout qu'on emporte. On
s'est attelés sur sa vitrine ; tout par l'effort s'est
écroulé... Ça fit un énorme
barouf !
(...) De la dame immense il pleut des objets partout...
Des bibelots volés. Il lui en retombe de tous les
plis... Sa garniture se débine... Elle les repique au
fur et à mesure... Devant César, le bijoutier, elle
s'est rafistolé sa robe, elle s'est recouverte de
sautoirs et de perles entièrement fausses... Tout le
monde en a ri... Et puis un saladier entier de pierres
améthystes qu'elle a semées à pleines poignées à travers
la lunette d'en haut... On est tous tournés violet. Avec
les topazes de l'autre récipient, elle a criblé le grand
vitrage... Tout de suite, tout le monde est devenu
jaune... On était presque arrivés au bout du Passage...
Y avait foule immense devant notre cortège et ça
cavalait fort derrière... La papetière du 86 à qui
j'avais fauché tant de crayons, elle se cramponnait à ma
culotte... Et la veuve des armoires anciennes où j'avais
si souvent pissé, elle me cherchait à fond la biroute
!... Je rigolais plus... Le revendeur des parapluies
c'est lui qui m'a sauvé la mise, il m'a caché dans son
ombrelle.
(...) En traversant la Place Vendôme, un énorme coup de bourrasque a
dilaté la Cliente. A l'Opéra, elle s'est renflée encore
deux fois... cent fois davantage !... Tous les voisins
comme des souris se précipitaient sous ses jupes...
(...) Il fallait pourtant qu'on avance ! Surtout la
géante ! La nôtre ! Qu'avait deux planètes pour
nichons... (...) En traversant la rue de Rivoli, la
cliente a fait un faux pas, elle a buté dans un refuge,
elle a écrasé une maison, l'ascenseur alors a giclé, lui
a crevé l'œil... On est
passés sous les décombres.
(...) J'ai été longtemps à me remettre. La convalescence
elle a traîné encore deux mois. La maladie je l'avais
eue grave... Elle a fini par des boutons... Le médecin
est revenu souvent. Il a encore insisté pour qu'on m'envoye
à la campagne... C'était bien facile à dire, mais on
avait pas les moyens... On profitait de chaque occasion
pour me faire prendre l'air.
(Mort à crédit, Gallimard, 1990, p.100).
*********
Quand
les morts resurgissent.
Sur
les banquettes autour de nous des festoyeurs un peu
saouls dormaient déjà. L'horloge au-dessus de la petite
église se mit à sonner des heures et puis des heures
encore à n'en plus finir. Nous venions d'arriver au bout
du monde, c'était de plus en plus net. On ne pouvait
aller plus loin, parce qu'après ça il n'y avait plus que
les morts.
Ils commençaient sur la Place du Tertre, à côté, les morts. Nous étions
bien placés pour les repérer. Ils passaient juste
au-dessus des Galeries Dufayel, à l'est par conséquent.
Mais tout de même, il faut savoir comment on les
retrouve, c'est-à-dire du dedans et les yeux presque
fermés, parce que les grands buissons de lumière des
publicités ça gêne beaucoup, même à travers les nuages,
pour les apercevoir, les morts. Avec eux les morts, j'ai
compris tout de suite qu'ils avaient repris Bébert, on
s'est même fait un petit signe tous les deux, Bébert et
puis aussi, pas loin de lui, avec la fille toute pâle,
avortée enfin, celle de Rancy, bien vidée cette fois de
toutes ses tripes. morts, j'ai
compris tout de suite qu'ils avaient repris Bébert, on
s'est même fait un petit signe tous les deux, Bébert et
puis aussi, pas loin de lui, avec la fille toute pâle,
avortée enfin, celle de Rancy, bien vidée cette fois de
toutes ses tripes.
Y
avait plein d'anciens clients encore à moi par-ci,
par-là, et des clientes auxquelles je ne pensais plus
jamais, et encore d'autres, le nègre dans un nuage
blanc, tout seul, celui qu'on avait cinglé d'un coup de
trop, là-bas, je l'ai reconnu depuis Topo, et le père
Grappa donc, le vieux lieutenant de la forêt vierge ! A
ceux-là j'avais pensé de temps à autre, au lieutenant,
au nègre à torture et aussi à mon Espagnol, ce curé, il
était venu le curé avec les morts cette nuit pour les
prières du ciel et sa croix en or le gênait beaucoup
pour voltiger d'un ciel à l'autre. Il s'accrochait avec
sa croix dans les nuages, aux plus sales et aux plus
jaunes et à mesure j'en reconnaissais encore bien
d'autres des disparus, toujours d'autres... Tellement
nombreux qu'on a honte vraiment, d'avoir pas eu le temps
de les regarder pendant qu'ils vivaient là à côté de
vous, des années... On n'a jamais assez de temps c'est
vrai, rien que pour penser à soi-même.
Enfin tous ces salauds-là, ils étaient devenus des anges
sans que je m'en soye aperçu ! Il y en avait à présent
des pleins nuages d'anges et des extravagants et des pas
convenables, partout. Au-dessus de la ville en
vadrouille ! J'ai cherché Molly parmi eux c'était le
moment, ma gentille, ma seule amie, mais elle n'était
pas venue avec eux... Elle devait avoir un petit ciel
rien que pour elle, près du Bon Dieu, tellement qu'elle
avait toujours été gentille Molly...
Ça m'a fait plaisir de ne
pas la retrouver avec ces voyous-là, parce que c'étaient
bien les voyous des morts ceux-là, des coquins, rien que
la racaille et la clique de fantômes qu'on avait
rassemblés ce soir au-dessus de la ville. Surtout du
cimetière d'à côté qu'il en venait et il en venait
encore et des pas distingués. Un petit cimetière
pourtant, des communards même, avec les autres, ils
attendaient La Pérouse, celui des Iles, qui les
commandait tous cette nuit-là pour le rassemblement...
Il n'en finissait pas La Pérouse de s'apprêter, à cause
de sa jambe en bois qui s'ajustait de travers... et
qu'il avait toujours eu du mal d'abord à la mettre sa
jambe en bois et puis aussi à cause de sa grande
lorgnette qu'il fallait lui retrouver.
(Voyage au bout de la nuit, Livre de poche, 1956, p.363).
*********
La Publique, ou la
barque à Caron.
Moi, c'est le quai !... et je
peux dire, dans le noir !... ça,
le tout de même pas ordinaire
que je vois : que c'est pas une
péniche, du tout !... ah, moi
l'extra-voyant lucide !... c'est
un bateau-mouche, bel et bien
!... que je vois même son nom !
son nom en énormes lettres
rouges La Publique et son
numéro : 114 !... comment je
vois ?... peut-être d'une petite
lueur d'ampoule ?... d'une
vitrine ?... non !... toutes les
devantures sont bouclées !...
là, ça je suis sûr ! je regarde,
je vois toute la place... et
parfaitement La Publique !...
à quai... et les allées et
venues à bord... des gens par
deux... par trois... surtout...
par trois... ils viennent d'en
haut... le même sentier que
nous... il me semble... ils
montent sur le bateau... ils
parlent à quelqu'un... et ils
repartent... je dis : ils
parlent ?... je crois... je les
entends pas !... je les vois,
c'est tout... monter, se
croiser... par trois... l'allée
et venue par la passerelle... je
vois un petit peu leurs
figures... je peux pas dire non
plus... plutôt leurs
silhouettes... oui, certes !
troubles
silhouettes...
pas nettes... trouble aussi, moi
!... moi-même !... eh donc !...
qui serait pas trouble ?... j'ai
été un peu ébranlé... même
vachement choqué
!... je veux !... toute l'Europe
au cul !... oui, toute l'Europe
!... et les amis !... la famille
!... à qui qui
m'arracherait le
plus !... et pas ouf ! les yeux
!... la langue !... le stylo
!... la férocité de l'Europe
!... les nazis étaient pas
baisant mais dîtes-moi la
douceur d'Europe ?... J'exagère
rien... le beau " Mandat " !...
et tous les Parquets... j'ai
éprouvé certains
troubles,
j'admets... la preuve, je suis
pas très certain de très bien
voir ces allées et venues du
quai...
(...) Une
main ! une main me touche le
bras... je me retourne...
quelqu'un !... je vois un
personnage, une sorte de
chienlit... chienlit gaucho
boy-scout, un déguisé, quoi !...
(...) Oh ! mais là, d'un coup
j'y suis !... ça y est !... je
l'embrasse ! c'est lui !... on
s'embrasse !...
" Ah ! c'est toi !... c'est toi ! " On se rembrasse !... c'est La Vigue !
ce que je suis heureux ! La
Vigue, là !
(...) Bien sûr y a longtemps qu'on s'est vus... depuis Sigmaringen... il
s'en est passé... Traqués à mort
qu'on a été... pas qu'un petit
peu !... et en Cour !... ce
qu'il a pu être héroïque !...
quelle attitude ! je pense la
façon qu'il a fait face !... et
en menottes !... qu'il m'a
défendu !... y en a pas beaucoup
!... y a personne !... et la
horde chacale plein la salle
!... et qu'il a fallu qu'ils
l'écoutent !... forcés... que
c'était moi le seul patriote
!... le vrai patriote !... le
seul !... qu'ils étaient eux,
baveux, râleux, que venimeux
hyènes !
De le retrouver là, quai Faidherbe !... La Vigue !... La Vigue !...
- Parle pas si fort !... Je chuchote : " T'es du bateau-mouche ? "
Je voudrais qu'il me dise... "
Oui... oui... Anita aussi !...
fais attention parle pas fort...
Anita, ma femme... Anita est
dedans !... "
 D'habitude, je saisis assez
vite, mais là c'était beaucoup
d'un coup... La Publique,
Le Vigan dessus... Le Vigan,
gaucho !... à barbe blanche, moi
qui le croyais à Buenos-Aires
!... en plus, avec une Anita...
je la voyais pas cette Anita...
D'habitude, je saisis assez
vite, mais là c'était beaucoup
d'un coup... La Publique,
Le Vigan dessus... Le Vigan,
gaucho !... à barbe blanche, moi
qui le croyais à Buenos-Aires
!... en plus, avec une Anita...
je la voyais pas cette Anita...
" Elle est dedans... elle est aide-soutier... tu connais pas le soutier
non plus ? - Non ! " Le soutier
? d'où je l'aurais connu ?
" Mais si !... mais si ! tu le connais !... voyons !... c'est Emile !
Emile de la L.V.F. !... Emile,
du petit garage Francœur
!... c'est là que t'avais ta
moto ! " Il me remuait un peu
les idées... ah ! oui !... ah !
oui !... le garage Francœur...
la porte cochère... oui !... au
fait ! Emile... la L.V.F. !...
ma moto... je me souvenais
presque... oui !... c'est ça
!... il avait raison ! qu'était
parti à Versailles... et puis à
Moscou !... exact !...
exact !... on
avait su !... et puis qu'était
revenu de Moscou... la preuve
!... mais qu'est-ce qu'il
foutait soutier ? là quai
Faidherbe ?... La Publique ?...
soutier ?... l'Anita avec ! et
lui l'admirable La Vigue ?
Quoi ?...
cher Le Vigan !... receveur il
me tape, il me secoue sa
sacoche, une sacrée besace !...
ballante sur le ventre... et qui
sonne !... il me montre !... il
l'ouvre !... pleine de pièces
d'or !... plutôt une gibecière
!...
" Alors, t'encaisses ?
- Tu parles !... et que du dur ! le dur !... le dur !... la barque à Caron
! tu penses !... "
Je veux pas avoir l'air étonné... même je trouve ça tout naturel... " Bien
sûr !... bien sûr !...
- La barque à Caron ?... tu sais bien ?
- Oh ! oui !... oh ! oui !... évidemment !
- Maintenant tu vois c'est celle-là ! "
(...) Ah ! mais là... juste là
!... à peine là, un pied sur le
pont... un stentor, une voix ! "
Qu'est-ce que vous foutez ?... "
et puis des " tu "... " d'où tu
sors ? Qui t'es ? " il voit pas
l'être !... derrière lui,
l'être... il se retourne pas...
" Je sors de la fosse !... je suis avec eux !
- Ah t'es avec eux, voyou ! ah ! t'es avec eux, menteur ! saleté ! ah...
t'es avec eux ! "
Et buang ! vrang !... encore son crâne... en plein crâne ! bang
! de quoi il se sert ?... un
marteau ? vrang ! il
tombe évanoui !... il a pas vu
le monstre... pas eu le temps...
qui est-ce ?
" Je suis Caron t'entends ! "
Il revient à lui... il voit l'être... un formidable !... quelque chose !
il me raconte : au moins
trois... quatre fois comme moi
!... un Bibendum ! mais la tête,
alors, de singe ! un peu tigre !
moitié singe... moitié tigre...
rien que son poids il fait tout
pencher... tout le bateau !...
Je me marre
comme Emile raconte.
" Oh ! tu le verras !... pas de quoi rire !... au moins trois, quatre fois
grand comme toi !... je te dis !
quand il t'arrangera la tronche
! "
Mes petits ricanages... lui La Vigue, se tait...
" Tu le verras !... sa rame dans ta gueule !... tu le verras !... "
Il me promet...
" Il leur fend le crâne à l'aviron !... dis !
- Ah ?.. "
Comme surpris, je fais... l'aviron de Caron, qu'il veut dire...
" Tous ceux qui montent, il les arrange, tiens !... hein La Vigue ?... il
leur rame dedans... dans le
chapeau ! en plein ! il leur
godille dedans je te dis !...
hein, La Vigue ?
- Oui !... oui !... "
La Vigue confirme...
" Sa façon que personne lui manque !... la loi, quoi !... la loi !... et
que ça raque !... te dis !...
j'y aurais fait comme j'ai fait
: présent ! Emile !... mais les
ronds ? j'aurais eu des ronds il
me prenait ! pas un pli !... il
me finissait ! il m'embarquait !
je lui disais : " Monsieur,
voilà l'or !... " Gî ! avec les
autres ! avec lui : doulos !
doulos !... tu verras un peu ce
qu'il leur file !... ils ont
?... ils ont pas ? vrong ! brang
!... ombres ou ombresses !
chichis ?... zéro !... vrong
!... les ronds ! mon Amiral !...
(...)
Enfin, une chose... j'étais
descendu pour Mme Niçois, son
pansement, et je me trouvais
embringué dans un de ces
mic-macs !... mélimélo... où ça
allait ?... c'était tout
imaginatif ?... l'Anita, la
brune en bleu-de-chauffe ?...
l'aide-soutière d'Emile L.V.F.
?... et les êtres là, soi-disant
morts, que je voyais très bien
défiler, qu'arrêtaient pas...
traverser la place
ex-Faidherbe... et remonter
chercher leur obole ?... et tout
ça, hein ?... sans éclairage...
(D'un château l'autre, Livre de poche, 1968, p.109).
*********
|